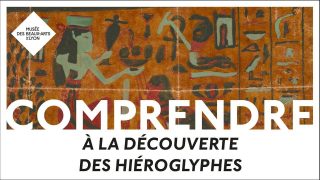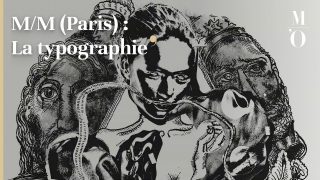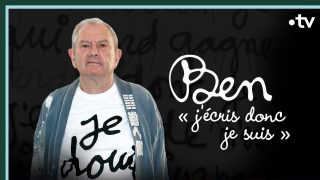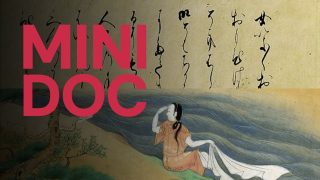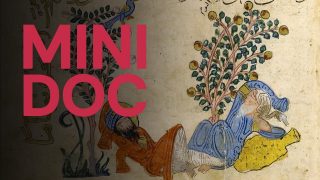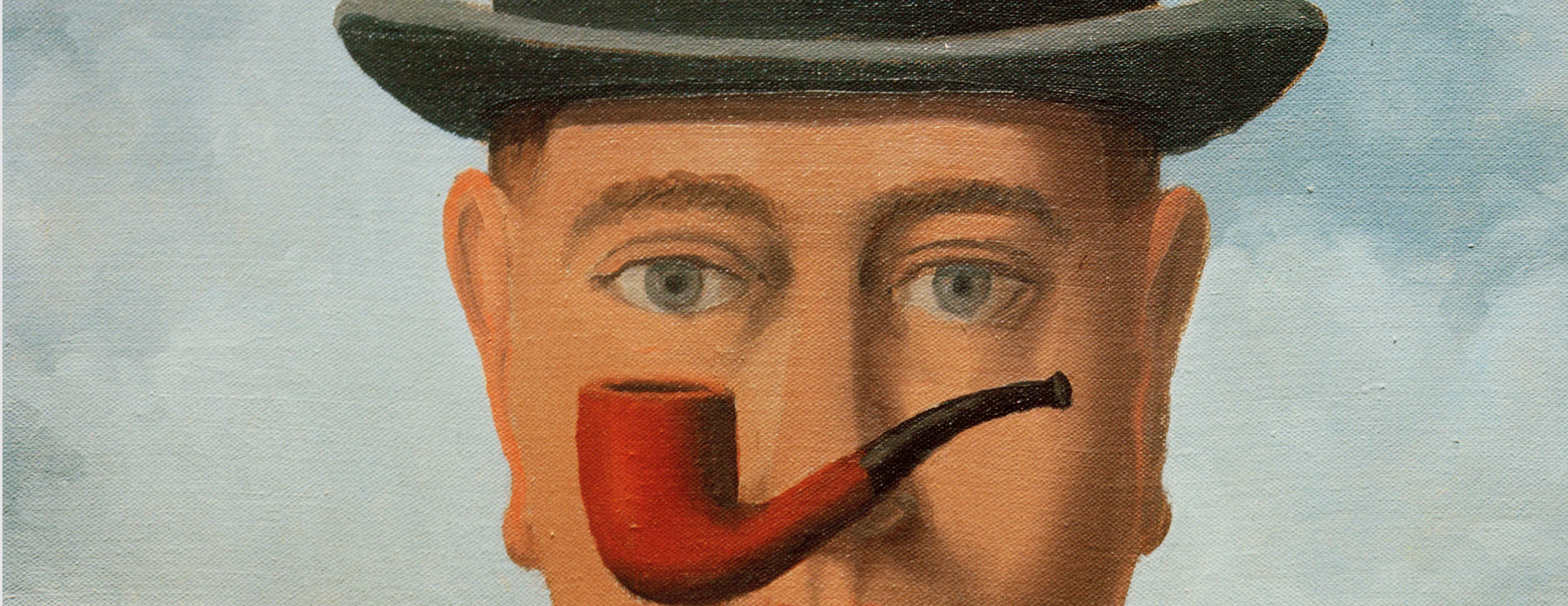Entre la fin du IVe millénaire et le début de notre ère, les anciens Égyptiens développent différentes écritures pour transcrire leur langue : les hiéroglyphes et leur forme cursive (le hiératique puis le démotique), et plus tard le copte.
À la fin du ive siècle après J.-C., le hiéroglyphique cesse d’être en usage, sombrant alors dans un oubli complet. À la Renaissance, des lettrés s’attachent à percer le secret de cette écriture originale, à laquelle on attribue une signification symbolique. Les premiers jalons du déchiffrement sont posés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans les années 1630, le savant encyclopédiste Athanasius Kircher (1602-1680) s’emploie à démontrer que le copte est le dernier état de la langue égyptienne antique et, en 1762, l’abbé Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) comprend que des cartouches entourent les noms royaux. La découverte, en 1799, par l’armée de Bonaparte en Égypte de la Pierre de Rosette – un texte bilingue, en égyptien (écrit en hiéroglyphes et en démotique) et en grec (toujours lu et compris) – enflamme les linguistes de toute l’Europe et lance la course au déchiffrement. Jean-François Champollion en sort victorieux, en raison de sa maîtrise de nombreuses langues orientales, anciennes et modernes – en particulier le copte –, et de sa connaissance de la civilisation égyptienne.
Contenu produit par : Musée des Beaux-Arts de Lyon