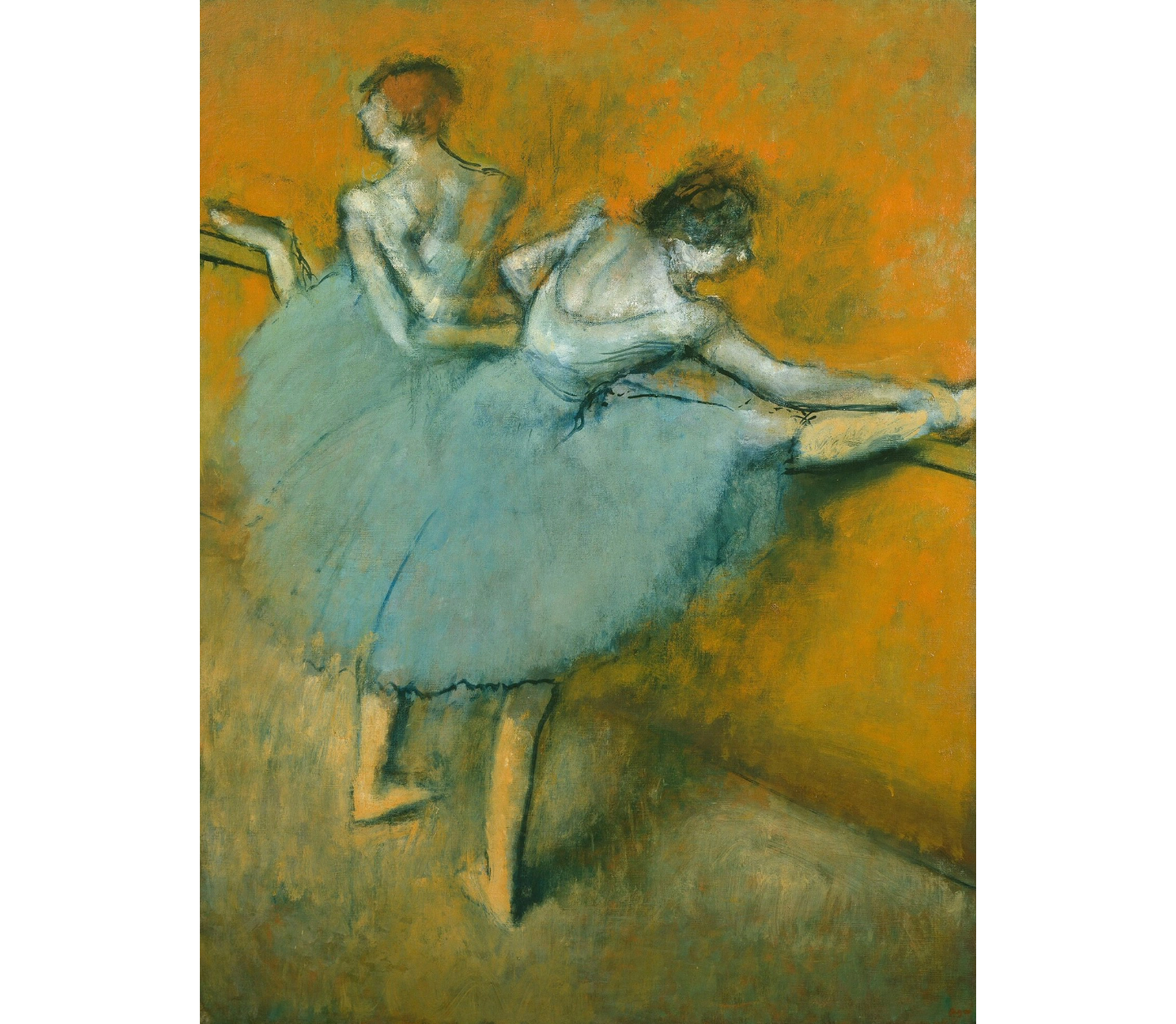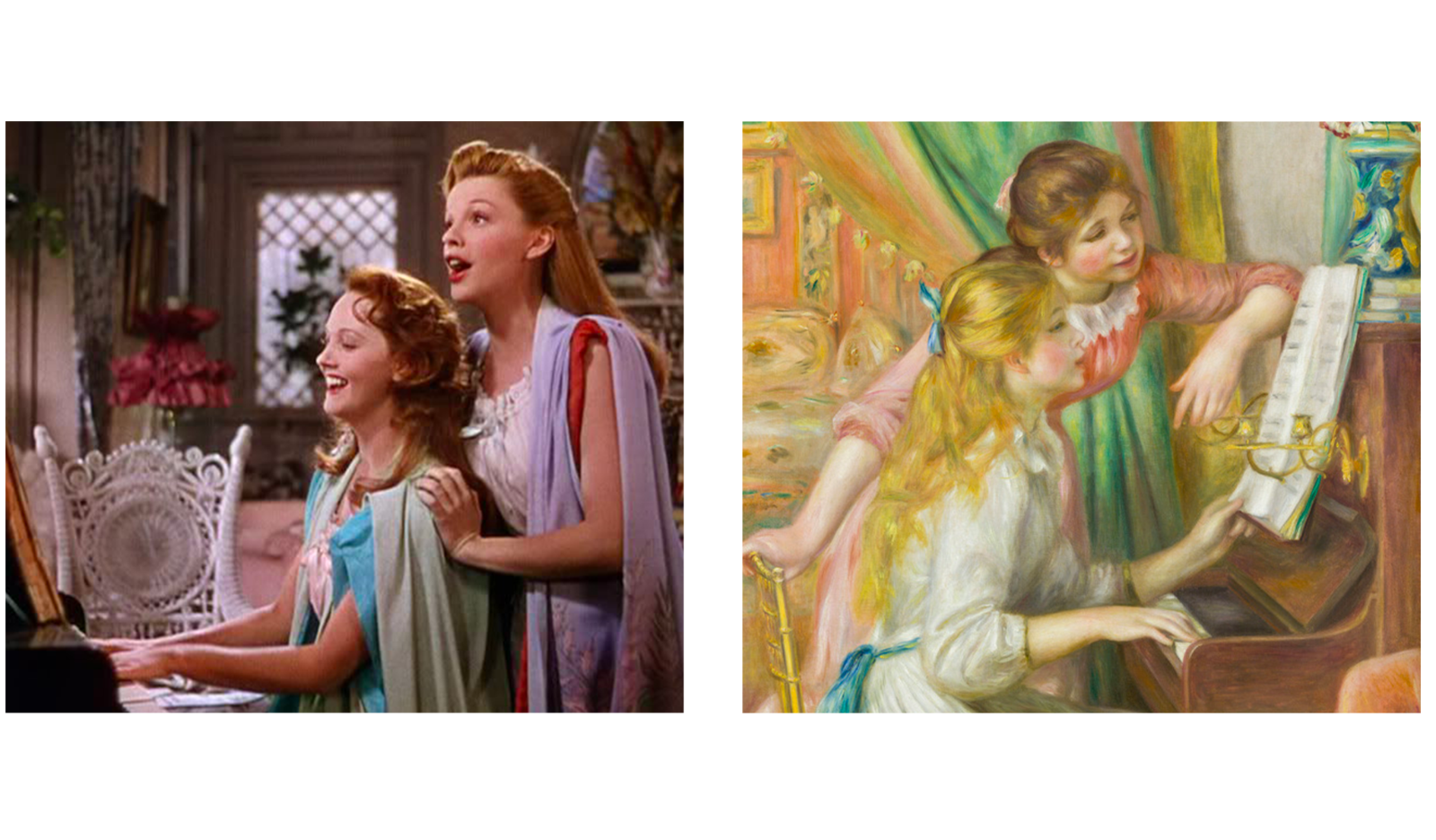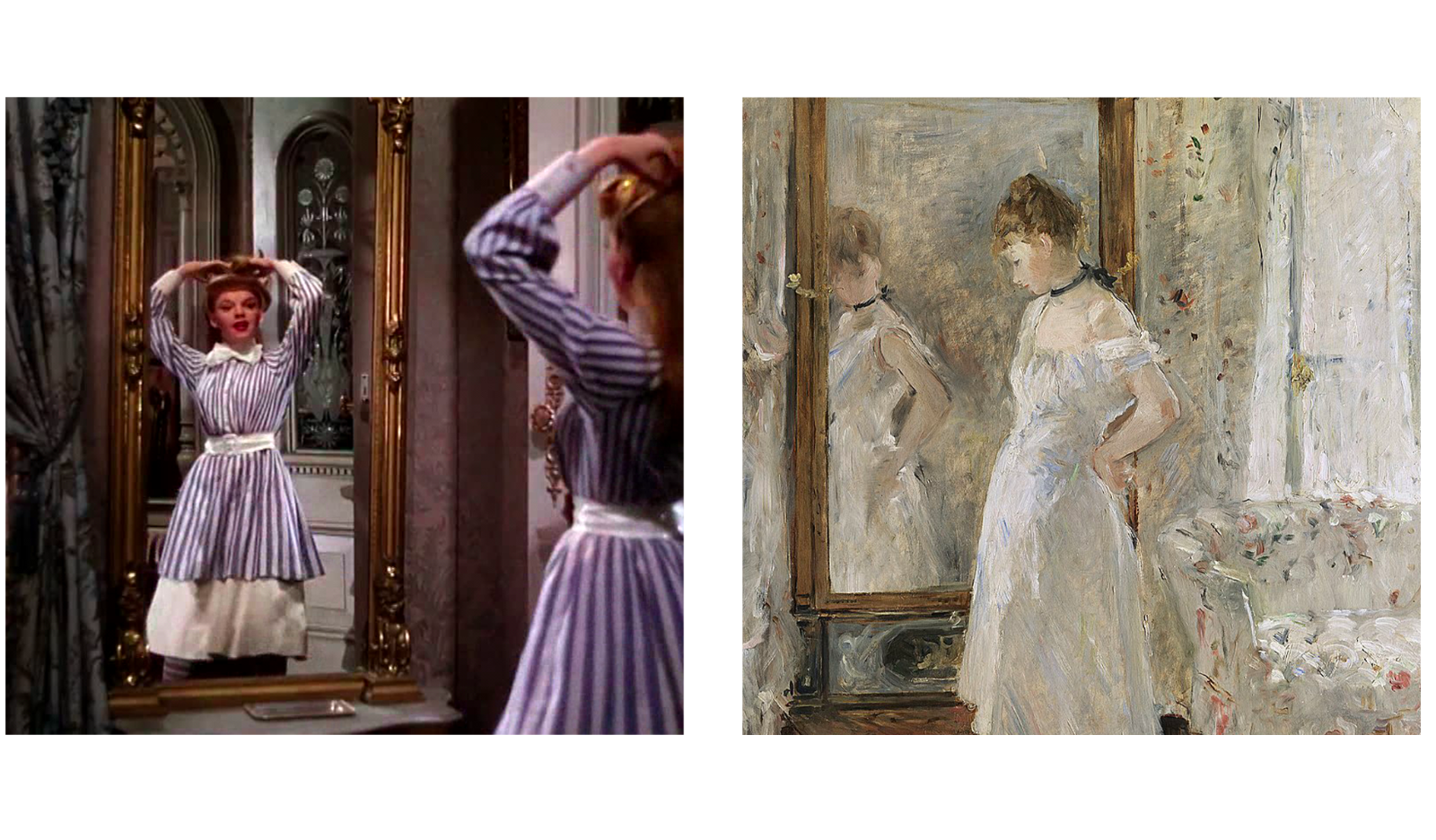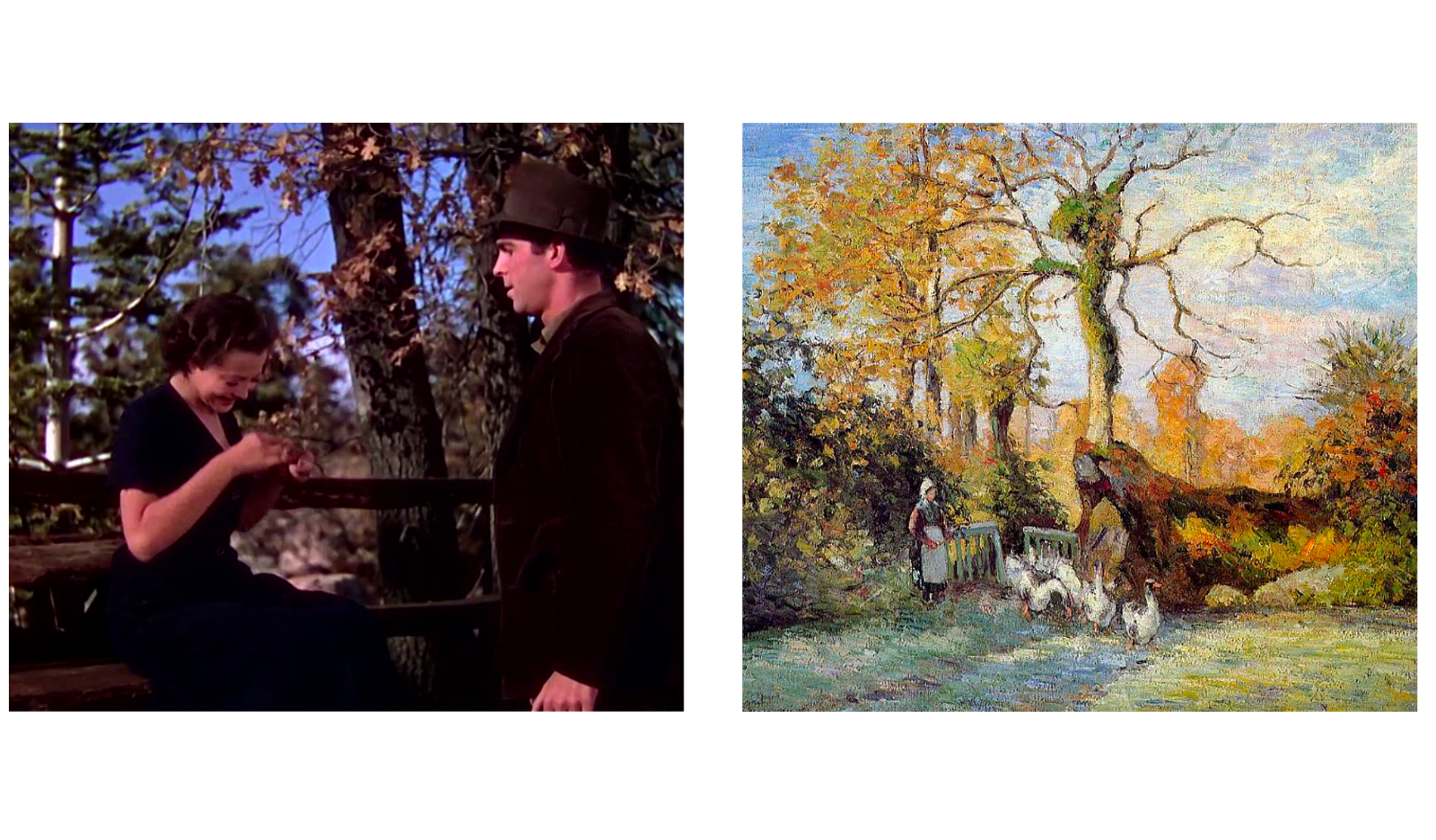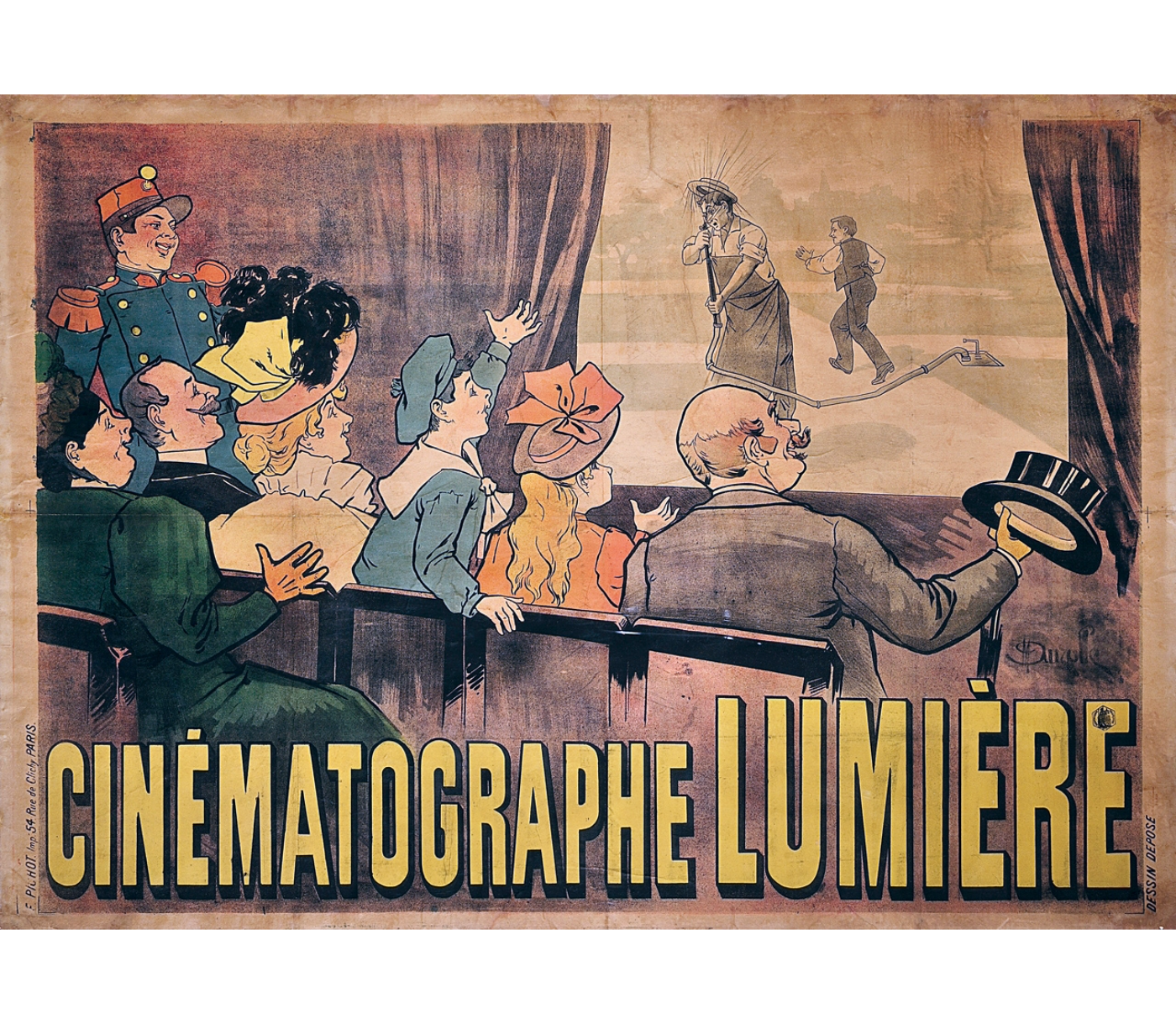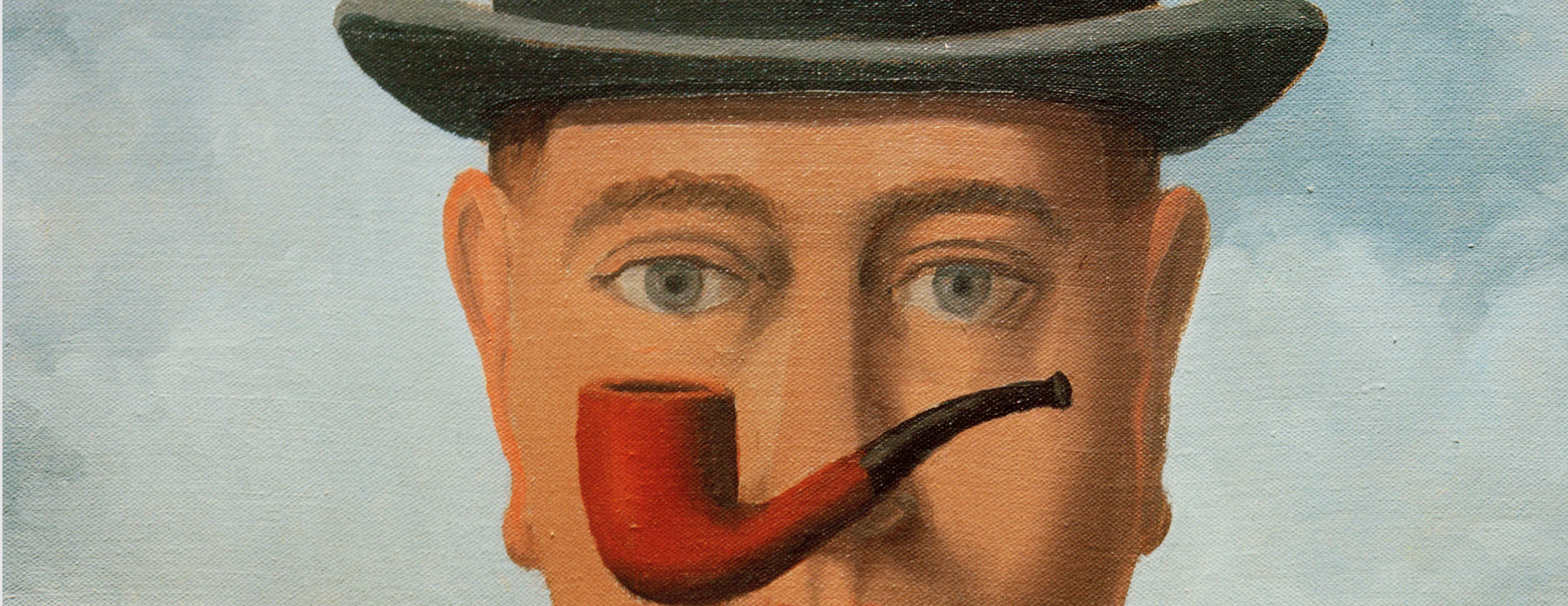Reste la dernière étape pour achever notre tableau : le vernis. Il protège la peinture, l’unifie et donne de l’intensité. Sauf que chez les impressionnistes, on préfère généralement s’en passer. Pissarro écrit même au dos de ses ses œuvres qu’il ne faut surtout pas les vernir !
En effet, cette couche, qui jaunit avec le temps, modifie les effets de brillance et les contrastes de couleurs… au point de gâcher les effets voulus par les artistes.
Hélas, cela n’a pas empêché certains propriétaires indélicats, à travers le temps, de vernir leurs tableaux. Les restauratrices du musée d’Orsay préfèrent aujourd’hui ôter ces couches pour respecter la volonté des artistes. Elles rendent ainsi à ces toiles tout leur éclat !